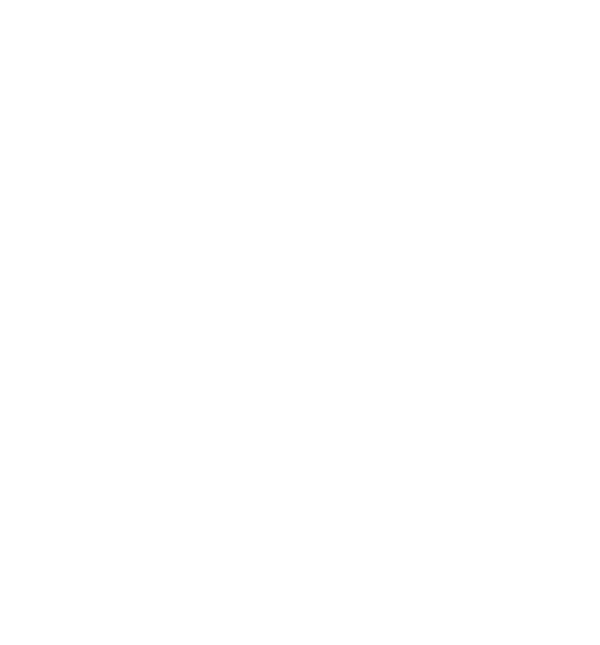- Editions Quart Monde
Feuilleton – J’ai cherché si c’était vrai – #12
- Publié le

Abonnez-vous au journal d’ATD Quart Monde !
Et recevez de nos nouvelles chaque mois dans votre boîte aux lettres, tout en soutenant nos actions via votre abonnement.
De L’Oréal aux bidonvilles de la banlieue parisienne, des ghettos new-yorkais aux favelas brésiliennes, le récit d’un combat dédié à tous ceux qui cherchent à « faire bouger les choses ».
Le temps du confinement, les Éditions Quart Monde vous proposent de lire (ou relire) gratuitement le très beau récit d’engagement J’ai cherché si c’était vrai. Bernadette Cornuau, une femme engagée, mis en mots par Jean-Michel Defromont et, pour l’occasion, en images par Petite Poissone.
Retrouvez-nous chaque mercredi et vendredi pour de nouveaux épisodes. Bonne lecture !
Pour retourner au début du feuilleton, cliquez ici.

XX
L’éducation du cœur
Chaque semaine, j’appréhendais de retrouver Bernadette plus mal. Après la relecture des débuts de son action dans le Nord, je craignais de la voir clouée au lit, les yeux fermés. Je l’ai trouvée attablée à son bureau, emplissant un chèque de son écriture tremblotante mais décidée. Comme je m’étonnais de la voir encore s’encombrer de paperasses, elle me répondit:
– Les factures, faut bien les payer…
Puis elle se leva lentement et, d’un pas prudent et mesuré, progressa jusqu’à son lit pour s’allonger. Comme d’habitude, j’installai le petit magnéto au-dessus de ses couvertures. À peine avais-je commencé à lui lire à voix haute qu’elle m’arrêta :
– Pas trop vite.
Ses yeux s’étaient fermés. Je repris :
J’en étais à : « Voilà comment, en sollicitant toutes les volontés disponibles, on parvient à ranimer une part d’humain dans toute une région. » Je continue :
Peu à peu, les deux femmes essaiment dans d’autres quartiers de la métropole. Ainsi une action démarre dans l’ensemble urbain des Hauts-Champs, à la périphérie de Roubaix.
Bernadette se souvient: « J’aimais y rejoindre Geneviève lorsqu’elle lisait des livres aux enfants, chantait avec eux en bas des immeubles. À la tombée de la nuit, les parents venaient les chercher, et les enfants aimaient tellement ça qu’ils ne voulaient pas partir, restant sous les lampadaires. Du coup, les parents restaient. Des plus grands venaient aussi. »
Les enfants seront toujours pour elle un ancrage. 1979, décrétée par l’ONU Année internationale de l’Enfant, intensifiera encore l’action culturelle auprès d’eux dans les quartiers, mais pas seulement. À l’époque, beaucoup sont retirés à leurs parents du fait d’une trop grande précarité. Avec eux, l’équipe part à la découverte de la vie de ces enfants qui ne grandissaient pas dans leur famille, mais en foyers ou dans des familles d’accueil. « Nous avions transformé les soirées Quart Monde en rencontres avec les directeurs, les instituteurs, les éducateurs de ces institutions. C’était émouvant parce qu’habituellement, les parents étaient convoqués individuellement pour s’entendre dire que leur enfant n’apprenait pas ou semait le désordre. Cette année-là, vingt, trente personnes avaient pu dialoguer pour la première fois ensemble avec les responsables de ces lieux, afin de se comprendre mutuellement. Les uns comme les autres en étaient sortis heureux d’avoir découvert un monde qu’ils ignoraient jusqu’alors, avec le sentiment d’avoir été compris, respectés. »
C’est alors que l’équipe apprend, par l’aumônier de la D.D.A.S.S. (Direction départementale de l’action sanitaire et sociale), qu’à Armentières existe un centre psychiatrique où vivent alors deux cents enfants dont personne ne veut, ni foyers, ni familles d’accueil.
Avec Geneviève, elles tentent de visiter ce centre, mais c’est interdit. Au cours de leurs démarches, elles rencontrent une éducatrice de jeunes enfants, puis une autre personne qui les alertent.
« Toutes les deux avaient été virées parce qu’elles avaient tenté d’améliorer les conditions de vie terribles de ces enfants, qu’on assommait de tranquillisants, qu’on maltraitait. Lorsqu’ils refusaient de manger certains aliments, on les enfournait de force dans leur bouche, y compris leur vomi. Il faut dire que les personnes qui en avaient la charge étaient elles-mêmes sans formation, se trouvant là dans un emploi pour lequel elles n’avaient pas été préparées, et dont d’ailleurs personne ne voulait, tellement c’était inhumain. À dix-huit ans, les enfants étaient transférés aux bâtiments des adultes. D’un bout à l’autre de leur vie, ils ne connaîtraient que ça. »
Elles essaient alors de rencontrer le directeur. Malgré les tentatives d’approche par des amis bien introduits, c’est un échec.
« Lorsque nous avons su qu’il faisait une intervention dans un congrès international à Lille, nous avons aussi essayé de lui parler, mais il nous a fuies. »
L’équipe apprend qu’un nouveau bâtiment pour accueillir un plus grand nombre d’enfants est à l’étude. La décision finale d’engager ou non ces travaux revient au préfet.
Aussitôt, Bernadette demande à le rencontrer. Le père Joseph et elle obtiennent un rendez-vous. Quand ils arrivent, le haut fonctionnaire a justement sur son bureau la demande de construction du deuxième bâtiment. Ils lui disent ce qu’ils ont appris sur les conditions d’enfermement de ces enfants privés de toute famille. Le préfet décide alors de faire diligenter une enquête sur la vie des deux cents enfants dans le bâtiment existant, et promet de ne pas donner son accord avant d’en avoir les résultats.
Avant de le quitter, Bernadette lui demande un autre rendez-vous pour faire le point. L’homme accepte. Les résultats de l’enquête confirmeront leurs dires. Plusieurs fois, ils se reverront pour évaluer la situation.
« Au fil des ans, dit Bernadette, les structures d’accueil évolueront vers un cadre de vie plus convenable. Par la suite, j’ai rencontré une douzaine de ces enfants qui avait été confiée à des frères franciscains. L’un d’eux, qui depuis longtemps avait perdu la parole, avait recommencé à parler quelques mois après avoir quitté cet univers infernal. Comment un tel abandon d’enfants dans le malheur à vie est-il possible ? »
Pendant tout ce temps passé dans le Nord, Bernadette se laissera guider par quelques familles qui seront pour elle comme une boussole dans l’entrelacement de ces petites rues étroites où tout le monde se connaît. Il y aura des figures locales, comme M. Priol, qui pousseront les volontaires à promouvoir, avec les familles enfermées dans leurs quartiers, des rencontres avec des gens d’ailleurs. Il y aura aussi des familles touchées par la vindicte. Elle se souvient par exemple de l’une d’entre elles avec sept enfants : « Les gars passaient autant de temps en prison que dehors, deux des filles étaient prises dans des circuits pas faits pour elles. » C’est dans cette fratrie que Pierre, quatorze ans, déjà connu comme faisant partie d’une bande écumant le quartier, un jour, a interpellé Bernadette. « Il m’a demandé s’il pouvait avoir un carnet de chants, en souvenir de ces temps avec Françoise et Brigitte, où ils chantaient ensemble avec d’autres sur la place Vanhœnacker à Moulins. Par lui, j’ai pris conscience que nous laissions des traces surprenantes chez les jeunes, et plus tard, chez les adultes, quelle que soit leur situation. »
Quand elle a quitté le Nord, elle dit: « Il y a eu une certaine nostalgie, bien sûr, mais j’ai toujours refusé la nostalgie. Elle n’est pas positive, pas constructive. »
Elle revoit encore « ces enfants n’ayant pourtant pas une vie d’enfants » tellement fiers de porter à travers les rues la banderole « Je voudrais que la vie soit pour tout le monde ! » et ce grand rassemblement au Forum des Halles à Paris, organisé par le mouvement le 13 mai 1979, où ils étaient des milliers venus de toute l’Europe : « Je me souviens d’avoir pensé : “ce n’est pas possible que ces enfants qui sont comme tous les autres enfants deviennent des adultes dans la misère…” Voir tous leurs visages, leur bonheur, leur participation, j’en avais été très émue. »
Pour conclure sur le Nord, elle redit son attachement à cette région à forte tradition d’engagement « où les enfants sont éduqués à regarder autour d’eux… » Elle ajoute, comme si c’était la cause : « C’est dans le Nord que les enfants travaillaient dans les mines, dans le textile tout petits… » Puis, citant quelques noms de personnes avec qui elle est restée en lien, elle finit, avec son petit sourire encore teinté de mystère : « Beaucoup m’ont dit qu’on ne leur avait jamais demandé autant. »
Sans doute faisait-elle allusion, entre autres, à sa détermination à solliciter des familles fortunées de la région, afin d’obtenir d’elles d’importants soutiens financiers permettant l’acquisition d’une maison Quart Monde à Lille, ce qu’elle gagna avant de quitter le Nord.
*
Depuis tout à l’heure, ses yeux se sont à peine ouverts, mais quand j’évoque l’expression « l’éducation du cœur » chère au père Joseph, elle s’anime : « Tu vois, quand je dis que dans le Nord les enfants étaient éduqués à regarder autour d’eux, ça fait partie de l’éducation du cœur. »
Elle redit ces gamins qui portaient fièrement à travers les rues leur banderole : « Réclamer que la vie soit pour tout le monde, ça fait partie de l’éducation du cœur. »
Puis, dans un long silence, elle cherche comment traduire cette part aussi cruciale qu’indicible de ce à quoi elle tient le plus.
Lentement, ses mots se posent : « C’est important, oui, cette éducation du cœur des enfants… Quand on fait une fête, aller chercher les enfants qui ne sont pas là… ne pas les laisser de côté… penser: est-ce qu’ils sont tous là ?… Ça fait partie de l’éducation du cœur… Cette éducation du cœur, elle existait en eux, elle existait en nous. Elle était renforcée par nous… Quand on fait découvrir aux enfants la grandeur de leurs parents… qu’ils continuent à vivre malgré tout pour leurs enfants, ça fait partie de l’éducation du cœur. »
Peut-on imaginer l’école de la République inscrire un jour dans ses programmes cette éducation-là ? J’aurais dû lui poser la question. Un peu plus tard, elle veut encore y revenir:
– Dans le mouvement, on a appris à aimer les gens.
– Qu’est-ce qui fait qu’on a appris ça ? Est-ce qu’on était comme ça avant, ou est-ce que c’est vraiment parce qu’on l’a appris ?
– Moi je crois que je ne l’aurais pas appris si je n’avais vécu qu’avec mon père. Nous, on essaie de voir tout ce qu’il y a de bien chez les gens, de positif, sur quoi on peut construire.
– Qu’est-ce que tu répondrais aux gens qui nous disent qu’on est des naïfs ?
– Non. On n’est pas des naïfs. On a eu cette chance-là… et on a su la prendre.
– La chance de quoi ?
– D’aimer les gens. On a su les saisir comme une chance. Comme une vérité.
Ses mots ont jailli, puis elle marque encore un silence et:
– Je me souviens, quand on s’est retrouvé avec mon père au Brésil… Au bout de trois jours, ça m’était devenu insupportable.
– Qu’est-ce qui t’était devenu insupportable ?
– Son regard sur les gens, toujours négatif… D’où lui venait cette amertume ? Je ne sais pas… Quelle chance qu’on ait appris à aimer les gens !
XXI
À la Sorbonne, « échec à la misère »
Depuis longtemps, le père Joseph avait cherché à ce que le monde des intellectuels et des scientifiques ouvre ses portes à ce qu’il appelait « son peuple ». Pour une rencontre aussi inédite, quel temple l’université pouvait-elle offrir de plus symbolique que celui de la Sorbonne ?
Au début des années 1980, alors qu’il avait confié à Bernadette, soutenue par Janine et Dominique Béchet, la responsabilité du mouvement en France depuis son nouveau siège, rue Bergère à Paris, le père Joseph leur avait demandé de préparer une grande soirée-débat à la Sorbonne ayant pour titre : « Échec à la misère ».
« Pour moi, explique Bernadette, cette conférence représentait une grande aventure qu’il fallait réussir: ouvrir la Sorbonne, avoir l’introduction de la présidente de cette université, que tout se fasse avec le plus de grandeur possible. Il ne s’agissait pas d’obtenir simplement un amphithéâtre, c’est une avancée pour la reconnaissance des plus méconnus qu’il fallait gagner. Gagner ce lieu déjà, parce qu’au départ, l’idée était seulement dans notre tête, et la Sorbonne semblait inaccessible. »
Alors ils multiplient les contacts, cherchent des gens pouvant connaître des professeurs, des responsables de cette fameuse université. Ils organisent des soirées d’informations pour bien situer l’enjeu de cette conférence : « Dans un haut lieu comme la Sorbonne, montrer que le savoir est libérateur de la misère et que le partage du savoir – je préfère dire le savoir mutuel – libère chacun d’entre nous et notre société. Le défi était de montrer d’une part que les gens à qui le savoir manquait le plus avaient le droit d’y accéder, et d’autre part que les détenteurs de ce savoir avaient à prendre conscience qu’il leur en manquait un précisément: le savoir de ceux qui en étaient le plus privés. »
Le 1er juin 1983, débordant de femmes et d’hommes dont la plupart n’en aurait jamais franchi la porte sans cette occasion, le grand amphithéâtre de la vénérable université résonna de la voix d’un homme et, à travers lui, de celle d’un peuple hors frontières, qu’elle n’avait pas perçue jusqu’ici dans ses murs. Cette conférence « Échec à la misère »5 marqua le début d’une nouvelle collaboration entre des pauvres et des intellectuels reconnus, à qui personne n’avait encore donné l’occasion de se parler, encore moins de penser ensemble pour faire exister ce qu’on appelle désormais: « Le croisement des savoirs », travaux d’élaboration de pensée, de savoirs et de formations réciproques entre professionnels, universitaires et personnes confrontées à la grande pauvreté.
*
Le tourbillon de cette mobilisation n’avait pas empêché Bernadette de se sauvegarder des espaces de liberté, guidée par une curiosité toujours neuve dans des petites escapades à la découverte d’un Paris méconnu.
« Dans le Marais, sur l’île Saint-Louis, dans les alentours de la rue Bergère, tu as des lieux extraordinaires, des impasses avec des petites boutiques absolument originales, des galeries d’artistes. » Pour découvrir tous ces lieux, elle préfère être seule.
« À plusieurs, on parle. Seule, tu es plus présente aux personnes que tu découvres, plus attentive. Je connaissais Paris puisque j’y avais déjà vécu, mais je ne le connaissais pas comme ça… Là, je cherchais l’invisible. »
Insaisissable Bernadette, chercheuse de l’invisible. Avec un peu de malice dans la voix, elle m’avait glissé : « Le père Joseph me disait: “On ne peut jamais te joindre !” »
Puis, retrouvant sa gravité, elle avait changé de registre : « Cette histoire de solitude et cette réaction du père Joseph me ramène à la dernière fois où je l’ai vu à l’hôpital avant son décès. Il est revenu sur ce temps de solitude que j’avais vécu à New York. Lui n’allait pas bien à cette période. Il était en Inde et il n’écrivait pas. Et sur son lit d’hôpital, juste avant sa dernière opération, la seule chose qu’il a tenu à me dire c’est: “Pardon de t’avoir laissée seule là-bas, il ne faut plus jamais que ça arrive. Plus jamais laisser personne seul face à la misère.” »
Et face à cette misère, on peut être seul en plein Paris. Et quand on s’affiche publiquement dans un engagement qui finit par vous donner pignon sur rue – ce qui, avec les années, devenait le cas pour le mouvement –, ce n’est plus tant la solitude qui pèse, c’est l’impuissance.
« Le jour, le soir, la nuit, des personnes vraiment désespérées téléphonaient, parce qu’elles avaient vu “Aide à toute détresse” dans le bottin. Des personnes vivant à la rue qui nous demandaient un logement, des personnes sans travail qui nous demandaient un travail, d’autres dont les enfants avaient été confiés à des foyers ou des familles d’accueil et qui voulaient les retrouver… Parfois, c’était des personnes qui venaient de se séparer de leur compagnon ou de leur compagne. Le jour, on m’appelait en bas à l’accueil pour les recevoir et le soir, la nuit, c’est moi qui les avais au téléphone. […] Ce qui m’a toujours poursuivie, encore aujourd’hui, c’est mon impuissance, notre impuissance. Je les écoutais évidemment, mais je n’avais aucune réponse. Je me souviens, on s’était renseignés sur toutes les adresses possibles, et en fait je leur donnais une liste d’adresses qu’elles connaissaient par cœur. Donc je les imaginais tourner en rond d’une adresse à l’autre sans avoir jamais de réponse. Parfois je n’en pouvais plus. Je débranchais le téléphone la nuit. Puis je le rebranchais en me disant: “Non Bernadette, tu ne peux pas faire ça.” Je n’étais pas fière de moi… Trois, quatre fois, on a pu aller au bout, trouver un logement, défendre une famille expulsée, mais par rapport à l’ensemble, c’est rien.
Dans le mouvement, on disait qu’on voulait atteindre ceux que personne n’atteignait. Je me disais: “Ce n’est pas vrai”. Ça me taraudait ces appels qui restaient sans réponse. Je n’ai jamais résolu cette question. Ça nous a quand même permis d’approfondir qu’il y a des personnes seules mais, qu’en réalité, alors que la vision générale était de les traiter en tant que personnes seules, la réalité, c’était qu’elles étaient d’une famille. Elles avaient dû la quitter, parfois parce qu’elles ne pouvaient plus la faire vivre, mais elles y pensaient tout le temps, leur espoir étant ou de retrouver leur famille ou de recréer la leur. Ce n’est que bien plus tard que le mouvement a rejoint des personnes à la rue, et les volontaires qui ont pris ces engagements-là vivent eux aussi cette impuissance. »